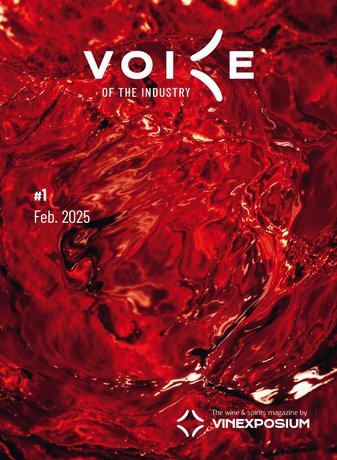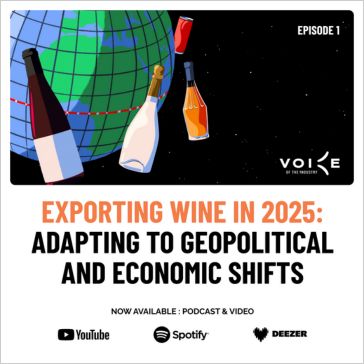Et si le futur de la vigne était ailleurs ?
Changements climatiques oblige, de nombreux vignerons s’installent dans de nouvelles régions pour produire du vin. Rencontre de néo-vignerons en Bretagne ou en Creuse, sur des nouveaux territoires viticoles.
Le 30 décembre 2015, vous ne le savez peut-être pas, mais une révolution discrète et silencieuse est venue bousculer à bas bruit le milieu viticole français. Le décret n° 2015-1903 change la donne en terme de « gestion du potentiel de production viticole » en France. Concrètement, ce décret ouvre la possibilité pour qui le souhaite de planter de la vigne sur des territoires jusqu’alors non viticoles ou anciennement viticoles et d’en commercialiser le produit.
Depuis cette date, nombreux sont ceux qui tentent l’expérience chez eux, dans leur région, jusque dans leur jardin. Nolwenn Runigo et Roland Conq font partie de ceux là. Bretons de naissance et passionnés de vins naturels, ils n’étaient pourtant pas destinés à la viticulture. Elle, travailleuse dans le social, lui musicien, ils ont décidés de se lancer en 2016 avec de l’achat de raisins en négoce d’abord afin de financer la plantation de 1,2 hectares de vignes en bord de mer, puis désormais, depuis le millésime 2023 avec une partie de leurs raisins du Morbihan, à proximité de Lorient. Leur démarche est davantage motivée par des enjeux politiques, sociaux et écologiques qu’économiques car le coût d’un hectare de vignes en Bretagne, surtout en bord de mer (une fois la terre achetée, la vigne plantée et palissée) s’avère bien supérieur à l’achat d’une parcelle existante en Loire-Atlantique voisine. Mais peu importe, car leur envie est de faire du vin ici, chez eux. A l’aide d’un portail géologique en ligne ils ont pu trouver leurs parcelles idéales, composées de granite, d’argile, de limon et même de calcaire, sur des talus entourés de végétation pour répondre à leurs envies d’agro-foresterie, chose assez rare en Bretagne.
Alors qu’au préalable il était autorisé de produire du vin pour une consommation personnelle en Bretagne, le décret de 2016 a rendu possible la commercialisation de celui-ci, changeant donc le paradigme de la viticulture bretonne et permettant ainsi de se professionnaliser. Localement leur démarche intrigue, mais elle n’est pas particulièrement soutenue. Ils n’ont reçu aucune aide financière pour se lancer. « Il y a un peu de méconnaissance car on est sur un territoire où la viticulture a été oubliée pendant plusieurs siècles, donc forcément on se tourne vers la Loire-Atlantique pour toutes nos questions, notamment les aspects douaniers ».
En Bretagne, on peut référencer plusieurs cas de figure, il y a des vignerons qui se tournent vers les cépages hybrides, avec l’espoir d’une meilleure résistance aux maladies, d’autres qui se tournent vers des cépages dits « nobles » comme le Pinot Noir ou le Chardonnay par exemple et enfin il y a des profils comme ceux de Nolwenn & Roland qui choisissent de planter des cépages moins connus du grand public et plus atlantiques comme le Pineau d’Aunis, le Grolleau Gris et Noir. N’étant pas soumis à un cahier des charges et à un système d’appellation, ils ont ainsi pu librement planter de l’Alvarinho, un vieux cépage galicien, pour essayer… Récemment ils ont aussi retrouvé sur la commune des bois de vignes préphylloxériques dont ils ne connaissent par l’origine ou l’identité exacte. Ils espèrent pouvoir replanter ces variétés anciennes adaptées au climat breton, finalement pas si mauvais qu’on le dit.
Xavier Marchais a 42 ans, il a été vigneron en Anjou de 2011 à 2021 avant de s’installer dans la Creuse, région rurale et vallonée du Massif-Central. Lui aussi à souhaité déménager pour repartir de zéro et pour s’ouvrir à la polyculture, notamment à l’élevage de brebis et d’agneaux dont il commercialise la laine et la viande à côté de son activité viticole. « C’est important pour moi, car on va vers des changements climatiques qui sont de plus en plus perceptibles, on a connu des années très dures de gel en 2016 ou 2017 en Anjou et on n’a aucune idée de comment vont évoluer les choses à l’avenir. Je crois que la polyculture est une réponse adaptée aux difficultés qu’on pourra rencontrer, et ça donne une autre vision de la terre. Tu ne vois pas les choses de la même manière quand tu fais une prairie pour des brebis ou de la culture de vigne ». Lui aussi passe par la case du négoce en 2021 pour se lancer avant de récolter cette année, en 2023, l’équivalent de 800 litres de ses raisins creusois provenant d’une des plus vieilles parcelles existantes de la région. L’aspect foncier a été un facteur déterminant dans sa décision de s’éloigner des terres viticoles historiques.
Pour lui, ces régions bien connues de la viticulture sont devenues avec le temps inaccessibles aux jeunes qui souhaitent démarrer une activité. En travaillant sans filet et sans chimie à la vigne comme au chai, il prend des risques financiers majeurs. Supporter le coût supplémentaire d’un endettement foncier serait donc impossible. « Au delà du coût, l’accès même aux terres viticoles est devenu compliqué, il faut faire partie du sérail pour pouvoir prétendre à des terres en Bourgogne ou en Champagne par exemple, mais c’est un problème du monde agricole dans son ensemble, pas seulement inhérent à la viticulture. » En Creuse le bâti est accessible et en nombre suffisant, notamment à cause de l’exode rurale qui a en partie vidé la région de ses habitants depuis plusieurs décennies. « Les vieux, à l’époque, ils devaient aller à Paris, s’ils restaient ici ils avaient un peu l’impression d’avoir raté leur vie. » Mais les choses évoluent, le hameau dans lequel il réside, totalement inhabité en 2010, se voit progressivement repeuplé, trois maisons sont à nouveau occupées et bientôt peut-être une quatrième.
Avec l’absence de parcelles existantes, il a fait lui aussi le choix de planter de la vigne à son arrivée en 2020, mais sans pour autant éviter les erreurs dans une région et un terroir qu’il connaissait mal. Il a d’abord planté en coteau, plein sud, avant de s’apercevoir que les sécheresses et canicules successives fragilisaient grandement ses plants par le manque d’eau. Il replante donc aujourd’hui sur des coteaux plus frais et exposés au nord pour éviter l’irrigation des vignes qui touche désormais pratiquement un quart du vignoble français. Pour se préserver du manque d’eau, il a fait le choix de palisser ses vignes en hautain, une méthode proche de la pergola et qui permet notamment à ses brebis de pâturer tout au long de l’année dans la vigne. Les conditions climatiques actuelles font de la Creuse un endroit intéressant pour produire des vins sur la fraicheur. « On est sur le Massif Central, des terroirs sur lesquels il n’y a plus rien à prouver, car tout est fait. » Il pourrait demander l’appellation Nouvelle Aquitaine pour sa production, mais à deux professionnels installés sur l’ensemble de la région, cela fait mince… « Après il y a plusieurs projets d’installations en ce moment avec des gens qui, comme nous, ont commencé à planter un peu de vignes. Il y a une dynamique et plein de nouveaux projets agricoles qui s’implantent partout en France. »
Pour Nolwenn, Roland et Xavier le décret de 2016 apporte une diversification bienvenue des terroirs français, mais aussi un espoir. Celui de ne pas répéter les erreurs historiques de l’agriculture en France. Repenser la vigne, repenser les terroirs donc, mais aussi la méthode. Pour eux, il est nécessaire de réimaginer la vigne non plus comme une monoculture, avec un travail du sol qui tasse et appauvrit, mais comme faisant partie d’un tout, en privilégiant le travail manuel, le paillage dans les vignes et en favorisant la biodiversité. Pour Xavier Marchais, il faudrait même aller plus loin et autoriser plus de cépages qu’à l’heure actuelle (une centaine de cépages de cuve sont désormais autorisés, contre 35 en 2016), en suivant l’exemple de pays voisins moins coercitifs. « Il faut bien comprendre que d’ici 50 à 70 ans, avec 2 a 3 degrés de plus, il y des territoires dans lesquels il ne sera plus possible de pratiquer la viticulture. Il faut donc s’adapter dès maintenant car la vigne c’est une plante qui doit être pensée sur le temps long. On plante aujourd’hui mais ce n’est pas tellement pour nous, c’est plutôt pour la génération d’après. Planter de la vigne en Angleterre, dans le Nord Pas-de-Calais ou en Bretagne prend aujourd’hui tout son sens. »
Par Valentin Le Cron